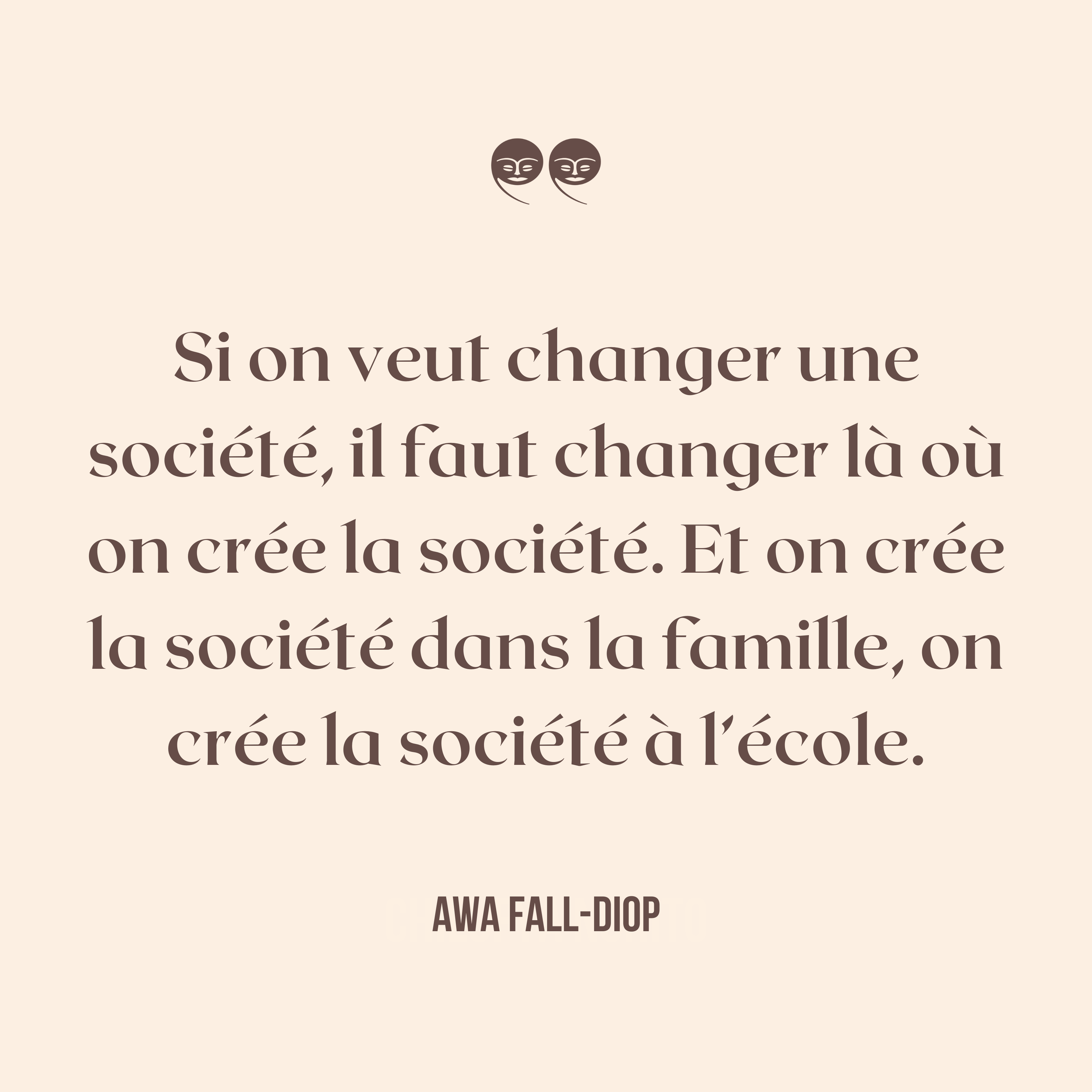« Si on veut changer une société, il faut changer là où on crée la société » - Awa Fall-Diop (Sénégal) 2/4
/Nous poursuivons notre entretien avec Awa Fall-Diop. Elle est une militante féministe sénégalaise, éducatrice et spécialiste des questions liées à la justice de genre et à la construction de mouvements sociaux. Dans la première partie de cette conversation, Awa Fall-Diop a partagé avec Chanceline Mevowanou les moments marquants de son enfance.
Dans cette deuxième partie, nous explorons les débuts de son engagement, la construction de ses convictions féministes et son combat pour l’égalité femmes-hommes dans l’enseignement et l’éducation.
************
Pour vous présenter, vous avez dit : « Je suis féministe panafricaniste, militante révolutionnaire pour la libération de l’Afrique, pour la libération du genre humain, pour la libération de toutes les femmes. » Comment vos convictions politiques se sont-elles construites ?
Je pense que depuis ma naissance, j’ai été éduquée comme féministe. Dans ma famille, quand on fait les louanges des femmes, on ne loue que ce qu’elles ont accompli. Je connais les femmes dans ma lignée sur 20 générations. Ce sont des femmes qui ne se laissent pas faire, bien qu’elles ne soient pas au même niveau de conscience politique que moi.
“Je pense que depuis ma naissance, j’ai été éduquée comme féministe. Je connais les femmes dans ma lignée sur 20 générations. Ce sont des femmes qui ne se laissent pas faire.”
Je suis née dans ça, une lignée de femmes qui ne se laissent pas faire. Je ne dis pas qu’il suffit de “naître dans ça” pour absorber cette éducation, parce qu’il y a d’autres personnes qui sont dans la même famille et qui n’ont pas les mêmes positions que moi. Peut-être que ce qui a traduit l’attitude féministe en une conscience féministe chez moi a été mon enrôlement dans les organisations marxistes, léninistes, maoïstes. Je pense que ça m’a permis de structurer mon tempérament et mon éducation en une vision politique.
Comment vous avez rejoint ces organisations ?
C’était au temps du parti unique au Sénégal. La création d’autres partis politiques était interdite. Ces organisations venaient faire de la sensibilisation et utilisaient le théâtre. On faisait du théâtre dans mon quartier. Ce qui se disait résonnait en moi. Ce à quoi elles appelaient correspondait à ce qui était en moi. Ça me parlait. C’est comme ça que je me suis engagée.
Est-ce que vous vous rappelez de la première organisation que vous avez rejoint ?
Oui. Et le nom de cette organisation signifiait « Agir ensemble ».
Comment votre implication dans ces organisations a-t-elle contribué à la construction de votre vision féministe et politique ?
Dans ces organisations, il y avait des sessions de formation sur le marxisme, la lutte des classes, sur le panafricanisme, sur Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, et Julius Nyerere. Donc, dans ce cursus de formation, on parle forcément d’oppressions. Et il était facile de lire l’oppression des femmes par les hommes, même au sein de l’organisation. On a commencé à les interpeller sur certaines pratiques qui étaient loin d’être des pratiques marxistes, donc loin d’être libératrices. On nous disait qu’il faut d’abord travailler pour la révolution, et c’est la révolution qui va régler les problèmes du peuple et les problèmes des femmes. On a dit non, qu’il y a des problèmes que nous devons régler ici et maintenant. On ne va pas souffrir en attendant la révolution. Ce qu’on voulait régler, ce sont nos rapports entre militants et militantes au sein de l’organisation. Et on peut régler ça.
Ce que vous dites est encore d'actualité aujourd'hui. De nombreuses jeunes féministes ont du mal à s'engager et à collaborer avec certaines organisations qui se disent panafricanistes, car leur vision de la libération du continent ne prend pas en compte les préoccupations des femmes et d'autres groupes marginalisés.
Ces organisations qui se disent panafricanistes avec une telle vision de la libération de l’Afrique n’ont certainement pas lu Samora Machel, Amilcar Cabral, Thomas Sankara qui parlent précisément de la libération de la femme. Il y a des choses que nous devons régler, notamment comme les problèmes dont souffrent les femmes et d’autres groupes marginalisés pour accélérer l’avènement de la révolution.
Pour vous, c’est quoi le féminisme ?
Pour moi, le féminisme, c’est une vision politique, un engagement politique de lutte contre toute forme d’oppression entre les hommes et les femmes, entre les femmes, et les relations entre les pays, et entre les continents. Tant qu’il y a une oppression, de quelque nature qu’elle soit, il y a une nécessité de la lutte féministe.
Quand vous dites « c’est une vision politique, un engagement politique », pouvez-vous expliquer ?
Oui. Politique, c’est différent de partisan. Et les gens font souvent la confusion entre les deux. Partisan, c’est de quel côté tu es. Par exemple, toi Chanceline, est-ce que tu es dans le parti républicain pour sauver le Bénin ? Est-ce que tu es dans le parti des démocrates ? Ça, c’est être partisan. Être politique, c’est avoir une conception globale du monde, de comment le monde devrait être organisé, comment il devrait fonctionner, quelle est la place de chaque élément, de chaque entité, pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux, les arbres, les fleurs, les mers, les fleuves, les rivières, le sol, le ciel, la terre, l’air. C’est ça, avoir une vision politique.
“Être politique, c’est avoir une conception globale du monde, de comment le monde devrait être organisé, comment il devrait fonctionner, quelle est la place de chaque élément, de chaque entité.”
Vous vous êtes aussi définie comme « militante révolutionnaire ». Qu’est-ce que ça signifie pour vous ?
Militante révolutionnaire, parce que ma conviction intime est que le changement est l’élément pérenne dans ce monde. Par exemple, depuis ce matin, on t’appelle Chanceline. Mais la Chanceline qui est entrée dans cette salle à 8 h n’est pas la même que la Chanceline qui est là, assise. Tu en es consciente ?
Je vois ce que vous voulez dire.
Que ce soit les êtres humains, que ce soit les choses, tout change. Être révolutionnaire, c’est accepter ce principe-là. Non seulement l’accepter, mais également chercher à le provoquer, là où il y a de la résistance, là où il y a des tentatives de conservation. Tu sais, même dans le mouvement écologique, je suis contre les mouvements de conservation de la nature. On ne peut pas conserver la nature, on peut la préserver. Parce que la nature porte en elle-même le changement. Donc, révolutionnaire, c’est être contre toute forme de conservation, toute idéologie conservatrice, tout mouvement conservateur. C’est avoir conscience que le changement est inéluctable.
Quelles sont les actions dans lesquelles vous vous êtes impliquée au début de votre engagement féministe ?
On a beaucoup fait de sensibilisations pour le changement des perceptions sur divers sujets : les droits, l’égalité, la dot, l’excision, la scolarisation des filles. Je me rappelle même qu’on faisait une de ces séances de sensibilisation une fois, et la police est venue nous ramasser en nous disant que c’était interdit. J’ai beaucoup travaillé sur ces sujets via des émissions, par des apparitions publiques, par des prises de parole. Par des pétitions aussi. Je me rappelle, il fut un temps où une femme travailleuse ne pouvait pas prendre en charge son enfant pour les frais médicaux. Alors que son collègue homme, de même fonction, de même grade, avait la possibilité de prendre en charge son enfant avec la sécurité sociale. Avec d’autres amies, nous avons commencé une pétition : « Nous sommes mères, nous sommes travailleuses ». C’est à partir de cette pétition que les organisations syndicales se sont saisies de cette revendication.
Des organisations syndicales de quel domaine ?
Des organisations syndicales d’enseignant·e·s. J’étais enseignante. J’enseignais le français à l’école élémentaire. Comme nous avons des amies dans les régions, nous avons fait circuler la pétition partout dans les régions, et on a eu énormément de signatures. Chacune d’entre nous a poussé au niveau de son syndicat pour que les syndicats prennent en charge collectivement cette revendication.
Vos convictions féministes ont-elles influencé la manière dont vous enseignez à l’école ?
Absolument. Au point même de créer une organisation appelée ORGENS, Observatoire des Relations de Genre dans l’Éducation Nationale au Sénégal. En tant qu’enseignante, je regardais les manuels de lecture et je voyais que toutes les femmes qui y figuraient, soit elles balayaient, cuisinaient, portaient un enfant, dansaient, se tressaient ou se coiffaient. Les hommes qui étaient illustrés dans les manuels, eux, étaient directeurs d’école ou occupaient d’autres métiers. Un jour, j’ai pris le manuel et je suis allée au ministère. À l’époque, André Sonko était ministre de l’Éducation. J’ai demandé à sa secrétaire : « Je veux rencontrer le ministre. » Elle m’a dit : « Vous avez une audience ? » J’ai répondu : « Non, je n’ai pas d’audience, mais je dois rencontrer le ministre. »
Vous avez eu une démarche déterminée
Le ministre sortait de son bureau. Je dis : « Monsieur le ministre, j’ai besoin de vous voir. » Il me dit : « À quel sujet ? » Je commence à parler et il dit à sa secrétaire : « Donnez-lui un rendez-vous, tel jour. » Et le jour du rendez-vous, je suis venue et je lui ai présenté ma préoccupation. Je lui ai dit : « Monsieur le ministre, dans le manuel, il y a 20 % de femmes alors qu’elles sont au moins 50% dans la population. Dans notre pays, dans les écoles, il y a des enseignantes, mais dans le manuel, seuls les hommes sont représentés à ces postes. Dans le manuel, il n’y a même pas une enseignante. Dans notre pays, il y a des sages-femmes, des femmes médecins, il y a des avocates. Mais cela n’est pas montré dans le manuel… »
J’ai continué : « Comment voulez-vous que les filles de notre pays puissent se projeter dans un avenir où elles sont autre chose que nourricières, balayeuses, ménagères… Comment voulez-vous que le taux de scolarisation augmente si les filles ne se projettent pas dans un avenir où elles occupent d'autres postes de responsabilité, monétisés ? Comment voulez-vous que les parents qui regardent ces manuels changent leur regard sur les filles ? etc. » Il m’a fixé un autre rendez-vous avec les directeurs des services. Et je suis revenue.
C’est impressionnant ce que vous avez fait.
Je suis revenue. Quand je suis entrée, un directeur m'a dit : « Mademoiselle, vous vous êtes trompée. Vous allez à quelle réunion ? » (Rires) J’ai répondu : « Je vais à la réunion avec le ministre de l’Éducation. » Il m’a dit : « Ah bon ? Avec le ministre de l’Éducation ? » J’ai dit : « Oui. »
Du sexisme quoi…
Oui. Ensuite, le ministre est arrivé et j’ai expliqué. On m’a dit : « Oui, nous avons bien pris note… Mais les livres, il faut d’abord que le coût soit amorti, pour qu’on puisse les changer. » Plus tard, les manuels ont été changés. Il y a des filles qui sont avec une loupe en train de scruter le ciel. D’autres avec le globe terrestre.
Bravo pour cette initiative. Quelles ont été les autres actions de Observatoire des Relations de Genre dans l'Éducation Nationale au Sénégal ?
Nous avons élaboré des modules de formation du personnel enseignant pour l’introduction de l’égalité de genre dans les situations d’enseignement-apprentissage. Et nous en avons formé pas mal. Aujourd’hui, si le genre est introduit dans les manuels, dans les situations d’apprentissage, c’est grâce à cette association-là. Une fois que ça a été fait, on s’est dit que notre mission était terminée. Parce que notre objectif, c’était d’institutionnaliser le genre dans le système éducatif.
J’ai vu que votre expérience avec l’Observatoire des Relations de Genre dans l'Éducation Nationale au Sénégal a été mise en avant sur votre profil en tant que Innovatrice Ashoka Changemaker.
Oui. Notre concept était simple : si on veut changer une société, il faut changer là où on crée la société. Et on crée la société dans la famille, on crée la société à l’école. Il y a beaucoup d’enseignants et d’enseignantes qui, après la formation, disaient qu’ils ne se rendaient pas compte de ces situations, parce que personne ne leur avait ouvert les yeux. Tu vois, c’est la raison pour laquelle il ne faut jamais avoir de préjugé comme quoi ça ne va pas marcher. Des gens ont certains comportements parce qu’ils ne savent pas. Mais une fois qu’ils savent, ils sont capables de changer de comportements.
Quel est votre plus beau souvenir en tant qu’enseignante ?
En tant qu’enseignante, mon plus beau souvenir, c’est de retrouver une de mes élèves dans l’une des plus grandes banques au Sénégal. Bon c’est le système capitaliste, certes, et je combats farouchement le système capitaliste qui est un système oppressif. Mais en tant qu'enseignante, j’ai eu beaucoup de satisfaction à voir qu’elle a réussi à se hisser. Une fois aussi, on était dans une manifestation politique, et j’ai vu deux de mes élèves qui étaient des journalistes reporters. Ce genre de choses me font énormément plaisir.
Alors, comment est-ce que votre engagement féministe a évolué ensuite ?
Il va falloir que j’y réfléchisse. Parce qu’en réalité, je me suis souvent laissée porter d’abord par la vague. C’est-à-dire, je passe quelque part, je vois qu’il y a des gens qui revendiquent, je viens, je me joins à la lutte. Et au fur et à mesure, je me retrouve au-devant du combat. C’est comme ça que mon militantisme s’est développé. Je n’ai jamais pensé spécifiquement à comment faire pour développer mon militantisme.
Dans la troisième partie de l’interview, Awa Fall-Diop partage ses analyses sur l’impact de la Conférence de Beijing (1995) sur les droits des femmes africaines et les défis persistants auxquels les mouvements féministes font face aujourd’hui. Cliquez ici pour lire cette partie.