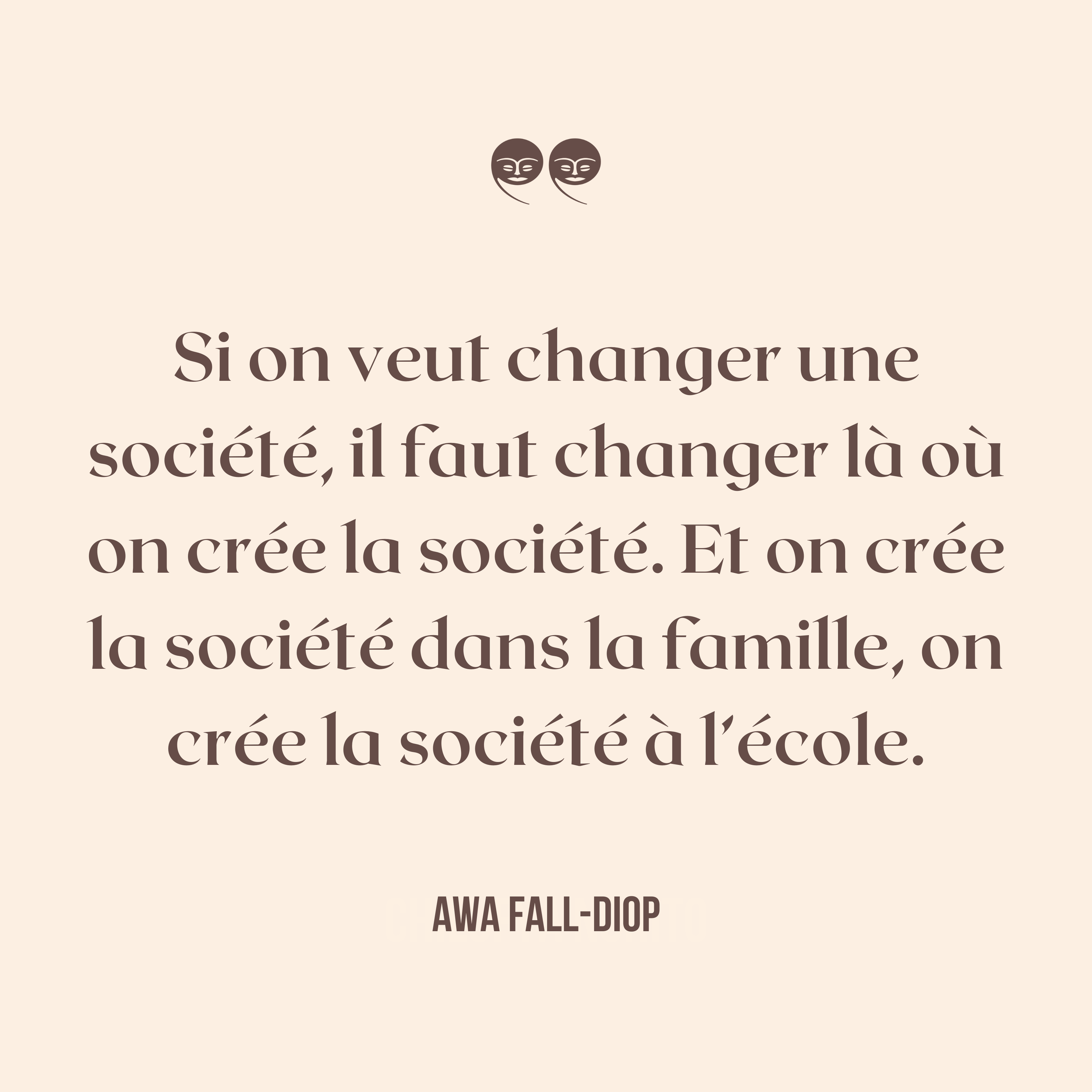Afrifem en Action : Sakinatou Ouédraogo présente l’ADDAD et sa lutte pour les droits des travailleuses domestiques (Burkina Faso)
/Notre série d’interviews Afrifem en Action met en lumière les initiatives, les actions et les mouvements créés et dirigés par et pour les féministes africaines. Dans cette interview, Chanceline Mevowanou échange avec Sakinatou Ouédraogo, présidente de l’Association de Défense des Droits des Aides-ménagères et Domestiques (ADDAD) au Burkina Faso.
Avertissement : Cette conversation contient des mentions de violence et d’abus qui pourraient choquer celles qui nous lisent. Veuillez prendre un moment pour décider si vous souhaitez continuer la lecture. Si vous continuez, nous vous encourageons à vous concentrer sur votre bien-être et d’arrêter la lecture à tout moment, selon vos besoins.
***************
Merci Sakinatou d’avoir accepté d’échanger avec nous. Peux-tu te présenter, s’il te plaît ?
Merci à vous aussi. Je m’appelle Sakinatou Ouédraogo. Je suis originaire de Bagnini, un village situé au sud du Burkina Faso. Je suis aide-ménagère depuis l’âge de 9 ans.
Comment tu t’es retrouvée à être aide-ménagère en étant enfant ?
D’abord, je viens d’une famille polygame. Ma mère a sept enfants et je suis la deuxième fille. Dans cette famille-là, à l’époque, nos parents avaient décidé que les grands frères, donc les garçons, iraient à l’école, et nous, les filles, on allait rester à la maison. Mais le gouvernement avait demandé d’inscrire tous les enfants à l’école. Donc, on a fait le CP1, le CP2, et le CE1.
C’est en classe de CE1 que, vu les difficultés que ma mère traversait, j’ai décidé, à l’âge de 9 ans, de me sacrifier. Ma mère était la première femme de notre papa. Elle n’avait pas accès à la popote comme l’autre femme. Les premières femmes ne sont pas prioritaires. J’ai décidé de venir à Ouagadougou pour travailler et avoir quelque chose pour elle.
Quand tu en as parlé à ta maman, elle a accepté ?
Je n’ai pas dit que j’allais venir à Ouagadougou. C’était la nuit, on était en train de causer au niveau du puits. On s’est rassemblées là-bas entre filles du village, parce qu’on vient chaque soir prendre de l’eau pour les maisons. Et là, on a discuté, on s’est dit qu’on allait fuir et venir à Ouagadougou. Parce qu’au village, les malheureuses se connaissent. Ceux qui sont les enfants aimés, eux aussi, ils se connaissent. On a décidé de venir à Ouaga, on était au nombre de 9. On vivait toutes les mêmes situations. C’est ce qui a précipité notre départ.
Quelle était cette situation, en dehors des difficultés de ta mère au sein de la famille ?
Il y avait plusieurs problèmes : les mariages forcés. À l’âge de 11 ans, 12 ans, on peut déjà t’accompagner chez ton mari. C’est ça qui a fait qu’on est venues vite à Ouagadougou. Il y avait aussi l’excision. Aujourd’hui encore, il y a toujours l’excision chez moi. On excise les filles, et ça, c’était un véritable problème. Sans oublier le manque d’éducation et d’eau. L’éducation est très faible au niveau des filles Pour aller chercher de l’eau, on doit marcher longtemps. Il n’y avait pas non plus d’accès à la terre pour les femmes.
Comment les gens réagissaient face à ce que les filles subissaient ?
Euh, les hommes n’ont jamais vu ce problème-là, parce que les hommes ne voient même pas que c’est un problème.
Quelle a été la réaction des parents lorsqu’ils ont appris que vous étiez parties ?
Quand on est parties, on n’a pas laissé de nouvelles. Juste au marché, il y avait une femme qui nous a vues à la gare avec nos sachets. Donc, elle a su qu’on partait. Et nous, on lui a dit de dire ça à nos mamans quand elles viendraient au marché. J’ai fait pratiquement deux ans avant de revoir ma mère. Donc, pendant les deux ans, je ne suis pas revenue. Je donnais tout le temps la commission. Il y avait des bus qui partaient vers les villages. Souvent, je chargeais la commission. Ceux qui conduisent les bus connaissent la famille. C’est à travers ça que ma mère a su où j’étais. Et elle est venue.
Comment avez-vous fait pour partir ?
(Soupirs…) De mon village à Ouaga, en ce temps-là, c’était 600 francs. Je ne sais pas si chez vous vous connaissez, mais on peut prendre certaines feuilles en quantité et les sécher. Tu mets dans un petit sac. Et tous les trois jours, c’était le marché de mon village. Donc, on y allait et on pouvait vendre ça. Les femmes de Ouagadougou viennent acheter. Et puis, tu auras ton argent. C’est comme ça qu’on a eu les moyens.
Quand tu es allée à Ouaga, comment ça s’est passé avec les autres filles ?
Quand on est arrivées, la première des choses qu’on voulait, c’était juste avoir un endroit où travailler. C’est à la gare que les femmes viennent nous chercher. Elles viennent chercher celles qui vont les aider à travailler.
J’ai toujours été dynamique. Donc, j’ai rapidement trouvé. C’était un endroit où je devais aller travailler seulement dans la maison. Quand ils m’ont amenée, j’ai commencé à faire tout le travail de maison, malgré mon jeune âge de 9 ans. Je finissais vite le travail qu’on me confiait. Ensuite, on m’a amenée dans un point de vente. Je finissais de travailler à la maison, et je partais dans le point de vente où je faisais l’attiéké. Déjà à 3 h du matin, je me levais. On devait commencer à frire les poissons, faire l’attiéké. Parce que le matin, les gens allaient manger et partir. Et le soir encore, on devait préparer. J’enlevais l’attiéké des grands sachets parce que ça venait de la Côte d’Ivoire. Ensuite, je mettais ça dans la grande bassine et dans la marmite. C’est ça qui a fait que, lorsque tu regardes mes pieds comme ça, tu vas voir les cicatrices.
Des cicatrices de quoi ?
Des brûlures de feu. C’est à force de monter sur les briques, car le fourneau était très grand. Je n’atteignais pas. Donc, je cherchais des briques pour monter. C’est le fourneau qui brûlait mon pied. Avec les mains aussi. Je suis restée là-bas deux ans. Je travaillais pour 4 500 francs par mois. Et j’envoyais mon argent à ma mère pour qu’elle paie les pagnes. Et souvent même, je payais les pagnes ici, à Ouagadougou.
Et les autres filles ?
Tout le monde est allé dans les lieux de travail. Il y en a d’autres, on était dans le même quartier. Après, je pense qu’on s’est retrouvées et on a décidé qu’on allait repartir au village. Elles sont parties, mais moi, je ne suis pas partie parce que j’avais le rêve de continuer les études. Donc, moi, je suis restée plus longtemps.
Tu disais que ta mère était venue plus tard. Comment cette retrouvaille s’est-elle passée ?
Ma mère est venue. Et quand elle est venue, elle m’a vue au point de vente. Je me rappelle très bien, elle est descendue, elle est venue me trouver. Je lavais les boîtes de sardines, de tomates conservées. Elles utilisaient ça pour que les gens boivent de l’eau dans les points de vente. Je lavais ça tout le temps et mes mains saignaient. Quand je voulais laver l’intérieur des boîtes, ça me coupait et mes mains saignaient.
Ma mère est restée là. Au début, je ne m’étais même pas rendu compte que c’était ma mère qui s’était assise. Ce jour-là, c’était un peu triste. Elle a voulu que je quitte, et que j’aille rester dans un foyer. Et je lui ai dit que je n’allais pas y aller. Je ne vais pas me marier au village. C’était un grand défi pour moi. Elle est repartie. Mais elle m’a demandé de lui promettre que j’allais changer d’endroit, parce qu’ici, ce n’était vraiment pas ça. Mes mains étaient tout le temps dans l’eau. Je descendais carrément à 23 heures. J’ai changé d’endroit.
Tu vivais où pendant que tu travaillais là ?
Je dormais dans la cour de ma patronne, sous un arbre.
Quand j’ai quitté là, je suis allée dans une maison où j’ai travaillé pour 10 000 francs par mois. La femme-là ne vendait pas. C’était une cité. Je faisais les travaux de maison. Je dormais à la dépendance et je suis toujours là. Quand elle a besoin de moi, elle me dit de venir, je nettoie tout. Je prépare à manger, je dépose sur la table à manger. Je suis toujours restée à l’intérieur. Il y avait deux voitures que je lavais aussi. Je suis restée pendant très longtemps. Je suis peut-être restée là-bas peut-être trois ans. J’avais une bonne relation avec les personnes pour qui je travaillais. Mais ce qui a fâché, c'est que j’ai fait du commerce.
Quel commerce ?
J’ai eu à faire le toffee au lait que je vendais. Quand je fais, je pars au marché, ou quand je pars déposer l’enfant, je donne ça au boutiquier à côté. C’était rentable. J’ai vendu presque une année et demie. Mais ça n’a pas été facile parce qu’ils ont découvert que je vendais. Et elle m’a demandé de payer les ustensiles.
À ces endroits où tu travaillais, personne n’a essayé de savoir d’où tu venais, ni pourquoi tu devais travailler à cet âge ?
Personne ne m’a jamais posé de question sur d’où je viens, ou bien pourquoi est-ce que je fais le travail. J’ai oublié un aspect important : là où je vendais l’attiéké, j’ai essayé de faire mon CEP, que j’ai eu avec l’entrée. J’ai demandé à faire le cours du soir, ils n’ont pas accepté que je le fasse. Le directeur venait manger là où on vendait. Il m’a dit que je pouvais faire l’examen. Donc, il a demandé mon acte de naissance et il a payé. Moi, je me contentais de prendre les cahiers des enfants de ma patronne et je lisais la nuit, parce que je ne dormais pas. Donc, chaque nuit, au lieu d’aller dormir, les enfants déposaient leurs cahiers et moi, je prenais leurs cahiers. J’écrivais également avec leurs ardoises. Je récitais à tout moment.
Je n’ai pas continué quand j’ai quitté là-bas. Avant, je travaillais pour 4 500 francs. Et désormais, 10 000 francs. C’était bien pour moi parce que je pouvais beaucoup faire.
Avais-tu des nouvelles des autres filles avec qui tu es arrivée ?
Quand j’ai été chassée de l’endroit, j’avais beaucoup d’argent. J’ai eu à payer de grandes bassines. J’avais très hâte d’aller au village pour que les gens voient mes bassines (rires). Le jour où je suis descendue au village, tout le monde était très content. Toutes les autres filles, pratiquement, sont venues voir. Certaines étaient venues avant que moi je n’arrive, d’autres qui étaient mariées. Moi, je ne me suis pas mariée, mais j’ai ramené les choses. Et malheureusement, il y a une fille, quand je suis arrivée, ils ont dit que la fille est décédée à Ouagadougou. Ils disent qu’elle était malade, et quand elle est venue, elle n’a pas fait une semaine au village, et puis elle est décédée.
Qu’as-tu fait ensuite, une fois de retour au village ?
Quand j’ai ramené tous mes kits de mariage…
Les kits de mariage ?
Oh oui. C’est pour que je me marie. Parce que chaque enfant a son mari. Chaque fille est déjà donnée. Et les vieux, là, le jour où tu nais, on te donne. Maintenant, si la personne veut, il peut prendre, donner à son fils, prendre et donner… Et les kits, ça signifie que c’est toi-même qui paies tes ustensiles. Tu payes tout, et puis tu pars chez ton mari. Quand je suis revenue, ils ont dit qu’on devait venir me chercher. Et c’est encore une deuxième fuite pour moi, pour revenir.
J’ai fui le lendemain, parce que lorsque tu arrives là, on ne te dit pas quel jour est-ce qu’on vient te chercher. Mais tu sais tout simplement que c’est dans les jours à venir. Parce que chez nous, les enfants de 15 ans sont déjà partis. 15 ans, 16 ans, toi, tu es déjà partie. Parce qu’il y en a même de 11 ans, si tu as une grosse corpulence, tu es partie. Donc, le lendemain, j’ai continué ma route. Je suis revenue à Ouagadougou.
Tu as continué à travailler après ce retour ?
Oui. Quand je suis revenue, je suis restée toujours dans le travail domestique, chez une nouvelle personne. C’était le directeur d’une chaîne de télévision qui m’a prise comme aide-ménagère. Mais à son temps, lui aussi, il était jeune. Il m’a dit : « Est-ce que toi, tu as étudié ? » J’ai dit : « Bon, j’ai le CEP, j’ai l’entrée, mais je ne suis plus repartie. » Il dit : « Tu peux t’inscrire à l’école, tu peux aller et revenir nettoyer. » C’est comme ça que je suis allée en classe de sixième.
À l’école, les professeurs ont dit, au premier trimestre, que je pouvais aller en classe de cinquième. Donc, j’ai sauté la classe de sixième pour aller en cinquième. Cinquième, quatrième, j’ai tenté le BEPC et je ne l’ai pas eu. Ça a coïncidé avec tant de stress. Ils demandaient à ce que je vienne, mon père était décédé. Je devais donc y retourner. Quand je suis arrivée, ils ont dit : « Toi qui es repartie, tu l’as déshonoré. Et c’est à cause de toi qu’il est mort. C’est les papiers que tu veux ? Il faut garder tes papiers. » Et depuis lors, je n’ai plus eu le courage de continuer.
Quel regard ta mère portait-elle sur tout ce que tu endurais ?
Ma mère ne m’a jamais accusée. Elle a toujours dit que, à cause de ce que j’ai fait, que j’envoyais quelque chose. Et même tous ceux qui parlaient savaient ce qui se passait, mais voulaient tout simplement, je pense, me faire du mal. Je suis repartie. J’ai commencé à faire du trottoir. Et j’ai commencé à être indépendante, petit à petit. J’ai fait venir ma mère à Ouagadougou. Je l’ai rejointe. Après, je ne travaillais plus dans les maisons. Je partais nettoyer, laver les habits et je revenais.
Tu disais que tu avais commencé à devenir indépendante. Tu peux expliquer ?
Je pouvais faire du commerce et, quand même, je vivais chez mon patron. Je faisais du commerce, je sortais, je faisais mes livraisons, je revenais, je faisais même des réunions, et on faisait des cotisations. Entre aides-ménagères, lorsqu’on faisait des cotisations, on donnait à une personne, et ça faisait beaucoup d’argent.
Comment as-tu connu ces autres aides-ménagères ?
C’est dans le quartier. On se connaît, en fait. Lorsque tu es dans un quartier, si tu es gardien, tu connais les autres gardiens. C’est comme ça. Et on a essayé de se mettre ensemble. J’ai toujours eu l’idée d’être ensemble. C’est de là qu’est née même l’association. Parce que, quand on s’est mises ensemble, on faisait les cotisations. Après les cotisations, s’il y avait des choses, j’enseignais. C’est ce qu’on faisait. Et c’est là que l’ADDAD (Association pour la Défense des Droits des Aides-ménagères et Domestiques) est née.
Explique-moi comment l’association est née.
D’abord, ce n’était pas une association. C’était une petite tontine, un espace d’écoute et de partage entre aides-ménagères et domestiques. Là où ma mère était, il y avait des réunions avec des gens du Réseau No-Vox. Moi, je partais à la réunion parce que c’était chez moi, là-bas. Ils venaient et parlaient des accaparements de terres, des non-lotis, des bidonvilles… Je suis devenue secrétaire générale de la réunion (rires). Je prenais note, parce que c’est moi qui savais écrire (rires). Les réunions même se passaient presque devant ma porte, parce qu’il y avait une grande table là-bas.
Lors d’une des réunions, un monsieur, m’a demandé : « Comment est-ce que tu t’appelles ? » J’ai dit : « Je m’appelle Sakinatou. » Il a dit : « Tu disais que tu as travaillé dans le ménage ? » J’ai dit : « Oui, j’ai travaillé dans la maison, mais aujourd’hui, je fais du nettoyage. » Il dit : « On a une association comme ça au Mali, créée par les filles aussi, travailleuses domestiques. Est-ce que tu peux faire ça ? Tu connais combien de jeunes filles ? » J’ai dit : « Je connais beaucoup » (rires). Et voilà, il dit : « Allez-y, vous allez vous mettre en association. Vous dites que votre nom c’est ADDAD Burkina. Parce que c’est ADDAD Mali qui est là, et vous dites ADDAD Burkina. » C’est là qu’ils ont envoyé les statuts.
En effet, j’ai vu dans mes recherches qu’il y a ADDAD au Mali et même au Bénin. Vous vous êtes ensuite enregistrées ?
Oui. Comment est-ce qu’on a eu ce récépissé au Burkina ? Ça a été un vrai problème. On a d’abord cotisé une année pour avoir les 30 000 francs. On ne pouvait pas avoir la somme comme ça. Et là, quand on est allées déposer notre demande, ils nous disent que le nom, c’est problématique. Les aides-ménagères ne peuvent pas être en association. Que ça, c’est quel pays ça ? Pourquoi est-ce que les aides-ménagères veulent être en association ? On s’est battues, on partait, on nous disait qu’il y a une virgule qui manque, il y a un « a » qui manque, il y a un « s » qui manque… Ils ont fait comme ça jusqu’en 2015. Et chaque jour, si on voulait y aller, on prenait le taxi pour y aller. Ça coûtait très cher. Donc, on est restées dans ça jusqu’en 2015. On a commencé le processus en 2012.
Quand on a obtenu le récépissé, on a été d’abord convoquées. Ils ont dit : « Est-ce que c’est une association qui va venir rebeller les filles ? » On a dit non, c’est une association pour pouvoir revendiquer nos droits. Ils disent : « Revendiquer ? Est-ce que vous qui êtes là, vous comprenez revendiquer ? » C’est la première fois que moi, j’ai été très parlante. J’ai dit : « Revendiquer, ça veut dire qu’on réclame ce qui nous appartient. » Donc, c’est comme ça qu’on a créé notre association. Petit à petit, on faisait nos réunions, on s’écoutait, on donnait nos idées. C’est chez ma mère qu’on faisait toutes les réunions. Ensuite, on informait les autres. Donc, on s’asseyait aujourd’hui, on était au nombre de 20. Demain, on s’asseyait, c’était 25, et après-demain, ça s’augmentait. On faisait des réunions du soir chaque semaine. Des gens venaient. Si on frappait une fille la nuit, qu’on faisait sortir ses effets, ils venaient et ils demandaient de venir m’appeler.
Ces cas de violences étaient gérés comment ?
On partait avec notre récépissé. Avec le récépissé, on a sauvé beaucoup de filles, et les patrons tremblaient parce qu’il y avait le cachet de l’État. Il y a une fille qui a travaillé durant deux ans… Elle n’a pas été payée, et quand elle est venue à notre réunion, on est allées avec elle. J’ai dit : « Tantie, on est là pour demander le salaire. » Et elle a dit : « C’est quel salaire ? Tu es déjà venue ici travailler ? » Je dis : « Non non, ce n'est pas moi. C’est celle qui travaillait chez vous. »
D’abord, elle nous a dit : « Quittez ma terrasse. » Et nous, on est descendues de la terrasse, et elle est allée détacher son chien. Moi, j’ai la grande bouche pour parler. J’ai dit que je suis là parce que l’État m’a chargée de venir (rires). Je fais sortir le récépissé pour le montrer. Quand je l’ai montré, la tantie a eu peur parce que c’est le cachet, là, qui est là. Et elle a commencé à dire de venir nous asseoir. J’ai dit : « Non. On n’est pas là pour s’asseoir. Aujourd’hui, soit vous donnez son argent, soit la brigade criminelle vient. »
Et comment la situation s’est-elle finalement résolue ?
Elle a dit qu’il fallait que son fils vienne, parce que c’est son fils qui garde l’argent. J’ai dit qu’on allait rester devant la porte. Elle a commencé à appeler son fils, son mari, en disant que c’est l’action sociale… (rires) Nos actions ont commencé comme ça. Le récépissé est devenu le papier qu’on utilise.
Il y a eu également un cas de viol. On est allées, et le monsieur nous a dit : « Qu’est-ce que vous avez comme preuve pour dire que c’est lui qui a violé la fille ? » Ça n’a pas été facile. On n’avait pas assez d’arguments. Il avait fait de grandes études. Et on a sorti notre papier. Il a dit qu’il se foutait pas mal de notre papier, et que là où on voulait que ça arrive, on n’avait qu’à y aller. Tu vois ce que ça nous fait ?
Comment avez-vous réagi ?
On a parlé aux femmes, et elles se sont levées pour venir avec ma maman. Elles sont sorties là, elles sont sorties. La fille était enceinte, et il a dit que ce n’était pas lui, qu’il s’en foutait, que même s’il avait violé la fille, est-ce que c’était lui ? Qu’il ne voulait même pas entendre ça. Quand les femmes sont venues, ça n’a pas été facile.
Il a dit qu’il ne faudrait pas que nous, les enfants, on oublie qui il est. Il disait qu’on voulait gâter sa réputation. Il a proposé de discuter, mais on a dit qu’on ne pouvait pas discuter et qu’on attendait la radio.
Ha, ça n’a pas été simple. Il a négocié. Et les femmes ont dit qu’on n’avait qu’à rentrer. Et quand on est rentrées, il a dit qu’il allait prendre en charge la fille, mais qu’elle n’allait pas rester chez lui. Qu’il allait s’occuper d’elle jusqu’à l’accouchement. Après, ils allaient faire des tests pour savoir. Après, la fille a avorté clandestinement. C’est devenu un renversement de situation. Le monsieur a dit qu’il allait nous convoquer, nous emprisonner, parce que si la fille avait avorté, c’était avec notre complicité. La fille a survécu. Mais ça n’a pas été facile.
Est-ce que ce genre de situation arrivait souvent ? Il y avait beaucoup de cas d’avortements clandestins ?
Beaucoup de cas. Elles prenaient des trucs. Beaucoup de filles perdaient la vie. On a pu en sauver certaines, parce qu’on a commencé à aller à l’hôpital avec elles pour dire que c’était des fausses couches. Parce que si tu fais un avortement, c’est condamnable. On te condamne, on t’emprisonne. Aucun médecin ne pouvait recevoir un cas d’avortement sans déclaration.
Ça a détruit beaucoup de filles. Parce que, quand les filles partaient, les médecins savaient que c’était ça. Donc, directement, on te disait d’aller faire une déclaration au commissariat. Or, à ce moment-là, si tu partais faire ça, ils allaient t’arrêter.
Aujourd’hui, comment l’association fonctionne ? Quelles sont les actions que vous menez ?
Aujourd’hui, on a eu un siège. On fait des campagnes de sensibilisation dans les villages avec des filles qui sont passées par ces situations, qui ont eu des problèmes, qui vont témoigner. Mais pas dans leur propre village. On change. On part avec les photos, pour informer. Comme ça, celles qui sont dans les villages et qui rêvent de venir à Ouagadougou clandestinement comme nous, ne viendront plus.
Pour les grossesses, lorsqu’il y a une fille qui tombe enceinte, dès qu’on le sait, en fonction de ce qu’elle souhaite, on l’accompagne. On parle aussi de contraception. Nous faisons des sensibilisations avec les filles. Mais il y a toujours ce problème au niveau des contraceptions. C’est très, très difficile. Si elles vont dans les centres de santé, on leur demande : « Tu as quel âge ? Tu fais quoi ? Pourquoi tu veux mettre ça ? Tu es venue pour travailler ou bien tu es venue pour coucher avec des hommes ? »
Il y a ces problèmes-là qui sont là, et surtout avec celles qui ont laissé le travail d’aide-ménagère pour partir dans la prostitution. C’est les mêmes problèmes que tu vas retrouver : v.i.o.l.s, grossesses…
Quand tu es retournée dans ton village après la naissance de l’association, comment ça s’est passé ?
Le jour où on a demandé à ce que les gens viennent chez le chef, parce que moi, je suis allée voir les chefs, et je leur ai dit que j’avais besoin de discuter avec tout le village, j’étais prête à dire tout ce que j’ai vécu à Ouagadougou et que je n’étais pas un exemple. Parce que j’avais constaté que beaucoup d’enfants venaient à Ouagadougou. J’ai demandé au chef de convoquer. Et pour cela, il faut payer les ignames, il faut payer le coq. On avait rassemblé tout l’argent pour faire tout ça. Ça nous a coûté quand même très cher, mais ça en valait la peine.
Comment tes messages ont été reçus dans le village ?
Ce jour-là, j’ai parlé de tout ce que j’ai subi. Et là, les mamans, pour ce que j’ai constaté, pleuraient beaucoup. Les jeunes filles, chacune partait se coller au mur, aux arbres et pleuraient aussi. Ce n’est pas moi seule qui ai témoigné. Il y a eu les autres filles qui ont témoigné, celle qui a subi les viols-là a témoigné. Et elle a rajouté encore que, même en venant, le car qui les avait amenées, ils partaient dormir d’abord dans un autre village. Ils marchaient pour aller dans un village, dormir là-bas, et attendaient que le jour du marché arrive, pour que le véhicule vienne dans leur village, et elles allaient prendre le véhicule pour venir. Quand elles sont allées dormir là-bas, le jeune qui les a hébergées les a toutes violées. Donc, elle a tout raconté. Et tout le monde a commencé à pleurer. Dans mon village, tu ne verras pas un enfant qui vient pour travailler encore. C’est très fort. Ça valait le coup.
Si tu devais raconter une histoire qui t’a impactée fortement depuis que vous avez lancé ADDAD, quelle histoire raconterais-tu ?
C’est suite à un v.i.o.l. Il y a un homme qui a v.i.o.l.é une fille. Et quand il a v.i.o.l.é la fille, moi, j’ai parlé de ça à la télé. Quand j’ai parlé de ça, ils ont dit que j’avais fait de la diffamation. Parce que j’ai tout dit. J’ai dit qu’on était allés au commissariat, et qu’on avait appelé le monsieur. On l’a enfermé, mais après, ils l’ont libéré. Moi, je suis allée à son bureau, je l’ai vu, et j’ai pris des photos.
Mais le monsieur en question, quand je l’ai vu, m’a dit qu’il allait me donner 500 000 francs. J’ai refusé. Donc, je n’ai pas accepté les 500 000 francs, et il est en liberté. J’ai dit ça à la police. Ils ont dit que c’était de la diffamation. On m’a arrêtée. Et le matin, quand on m’a arrêtée, je suis restée là-bas jusqu’au soir. C’est après 21h qu’on m’a dit que je pouvais partir. Mais on ne m’a pas laissée comme ça. On m’a mise avec les prisonnières jusqu’à 21 h.
Quand je suis repartie, le lendemain, au lieu de me dire de venir, ils sont venus me chercher comme si j’étais une voleuse. C’est mon mari qui m’a trouvé un avocat, qui m’a fait sortir.
Est-ce que ADDAD propose des hébergements pour les filles ?
Oui. On propose des hébergements, mais notre espace est très réduit, ce n’est pas beaucoup. Aujourd’hui, nous comptons plus de 1 700 aides-ménagères dans l’ADDAD. Uniquement à Ouagadougou. Avec les autres régions, on a également créé six antennes.
Avant, dans nos bureaux, il y avait 184 femmes et jeunes filles qui restaient ! Mais aujourd’hui, la mairie est venue dire que ce n’est pas possible. Il faut un endroit approprié si on veut être un centre, il faut une maison. Ce n’est pas le bureau qui doit être l’endroit où les femmes vont venir. Donc la mairie est venue et nous a demandé de nous séparer.
Comment l’association trouve-t-elle les ressources pour travailler ?
On a eu des financements. Mais dans le contexte actuel, ces financements, avec certaines structures sont coupés.
Quand tu te définis comme féministe, qu’est-ce que ça signifie pour toi ?
Quand je me définis comme féministe, ça signifie de l’espoir. Ça signifie la force, parce que c’est avec ça que je marche, pour aller dire que je n’accepte plus qu’on donne une fille en mariage. On dit que ce sont les cultures de mon village. Ce sont des valeurs, comme l’a dit notre chef, qu’il faut toujours défendre parce que ce sont les valeurs de nos ancêtres. Mais je l’ai toujours dit, je me suis rebellée parce que je voudrais tout simplement vous montrer que, même si on se rebelle, les ancêtres n’allaient rien nous faire.
Moi, la première fois que j’ai été v.i.o.l.é.e, j’ai pensé que des ancêtres allaient venir et qu’on allait me tuer… Mais non. Je suis restée là, personne n’est venu, je ne suis pas morte. J’ai été v.i.o.l.é.e, ce n’était pas le v.i.o.l qui m’inquiétait, mais c’étaient les ancêtres…. Tu vois ?
Avez-vous reçu de la solidarité de la part d’autres femmes ou structures quand vous avez commencé ?
Quand on a commencé à revendiquer vraiment que les aides-ménagères aient leur place, les femmes du marché ont été vraiment nos fortes alliées. C’est là où on va payer les condiments. Lorsqu’elles voient une fille, tu peux venir, on peut te frapper, te faire beaucoup de choses dans la maison, et on t’envoie payer les condiments. Donc ce n’est qu’au marché que tu peux t’exprimer. Ces femmes-là sont des points focaux.
Comment est votre relation avec d’autres féministes de ton pays ou dans la sous-région ?
Par exemple, quand je suis venue à l’Agora Féministe pour la première fois, si tu remarques bien, j’étais toujours en arrière. Au fur et à mesure, je pense qu’avec les autres féministes, c’est devenu une famille. Je pense que j’ai trouvé une bonne famille, une famille dont je rêvais depuis que j’étais enfant. Je n’ai jamais eu ça. Je n’ai jamais eu cette affection. Mais avec le féminisme aujourd’hui, j’ai cette affection. J’ai des gens qui se soucient de ma santé, j’ai des gens qui se soucient de ma bonne humeur. Avec les féministes de mon pays, je dirais que c’est très bien. Parce que lorsqu’elles ont des activités, elles m’invitent. Lorsque j’ai des activités, je les invite.
Comment peut-on soutenir l’ADDAD ou défendre les valeurs que vous portez à travers vos actions ?
Je pense que déjà, il faudrait penser à créer un espace pour toutes les filles. Toutes les filles ont leur place. Que tu aies eu tous les privilèges ou pas, tu as ta place et tu as ton mot à dire. Aussi, je voudrais également que les féministes, dans les différents pays, essayent de donner la chance à certaines filles comme moi de pouvoir continuer les études. Parce que pour moi, tu vois, c’est une des difficultés que j’ai aujourd’hui : pouvoir même bien parler le français. Si je parlais bien le français, je me ferais entendre mieux. Mais comme ça, je pense que c’est une petite barrière.
Mais s’il faut qu’on change cela, j’aimerais bien qu’on fasse des écoles, dans les différents marchés, dans les espaces publics. Des écoles, mais pas grandes. On peut louer ou on peut prendre, si c’est le marché, on paye le hangar, c’est une école pour les enfants. Mais tu sais, Chanceline, les enfants seront très ravis de venir à ces espaces et de comprendre le 1, 2, 3. Donc pour moi, c’est très, très important pour ces enfants. Et j’ai toujours pensé à ça. Également, pourquoi ne pas créer ces espaces-là et y mettre des livres, pour que les jeunes enfants puissent lire ? Ça va aider à leur donner cette chance-là de pouvoir apprendre quelque chose, parce qu’il ne faudrait pas qu’elles continuent toujours là où j’ai quitté, quoi.
Quels sont tes espoirs pour ADDAD ?
Mon espoir pour ADDAD, c’est de voir toutes les jeunes filles, que tu sois aide-ménagère ou pas, qu’elles soient autonomes, qu’elles puissent revendiquer leurs droits. Qu’un jour, il y ait des gens qui vont dire : « J’étais aide-ménagère, mais aujourd’hui, je suis ministre », « je suis présidente », « j’occupe telle entreprise ». C’est ce que je veux voir.
Comment toute cette lutte t’a impactée toi-même personnellement ?
Ce qui m’a impactée, c’est qu’aujourd’hui, aux yeux de ma mère, je ne suis plus Saki, mais je suis espoir. Elle l’a toujours dit. Voilà. Au lieu que tu sois cette honte qu’on m’a collée, tu n’as pas été cette honte. Je crois toujours en toi. Donc, je pense que je suis espoir.
Est-ce qu’il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter mais que tu n’as pas eu l’occasion de dire ?
J’aimerais bien que tout le monde… qu’on soit solidaires, qu’on soit là les unes pour les autres.
Merci d’avoir partagé ton histoire avec moi, Sakinatou. J’ai été très ravie de parler avec toi.
Qu’avez-vous pensé de cette interview ?
Partagez vos pensées et rejoignez la discussion. Et si vous vous demandez comment vous pouvez apprendre, soutenir ou amplifier le travail de l’ADDAD, connectez-vous avec l’association sur Facebook.
Vous pouvez également suivre Sakinatou Ouédraogo pour en savoir plus sur ses actions et engagements.