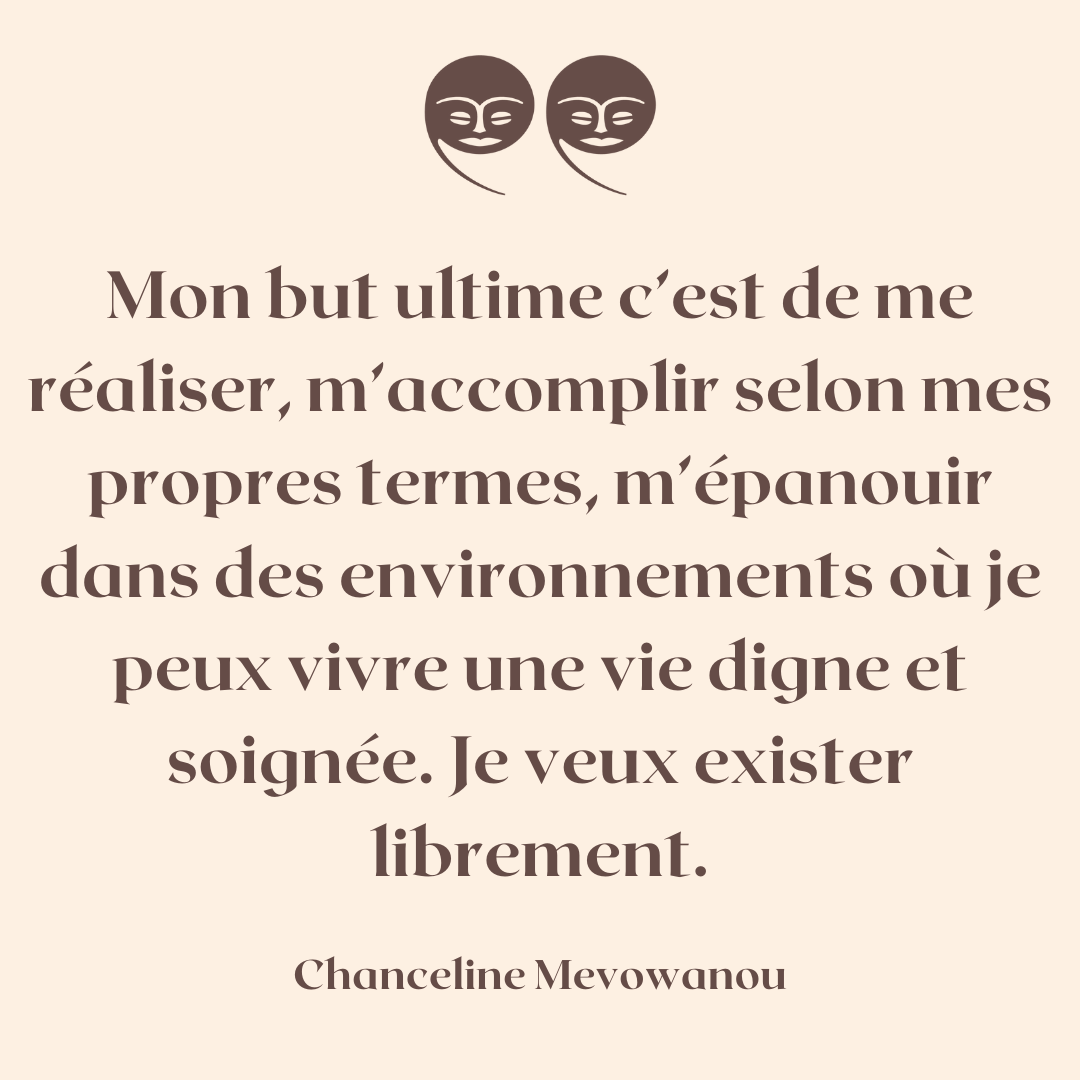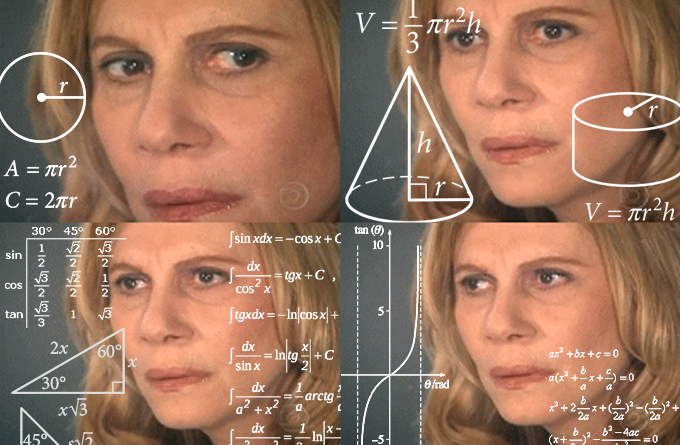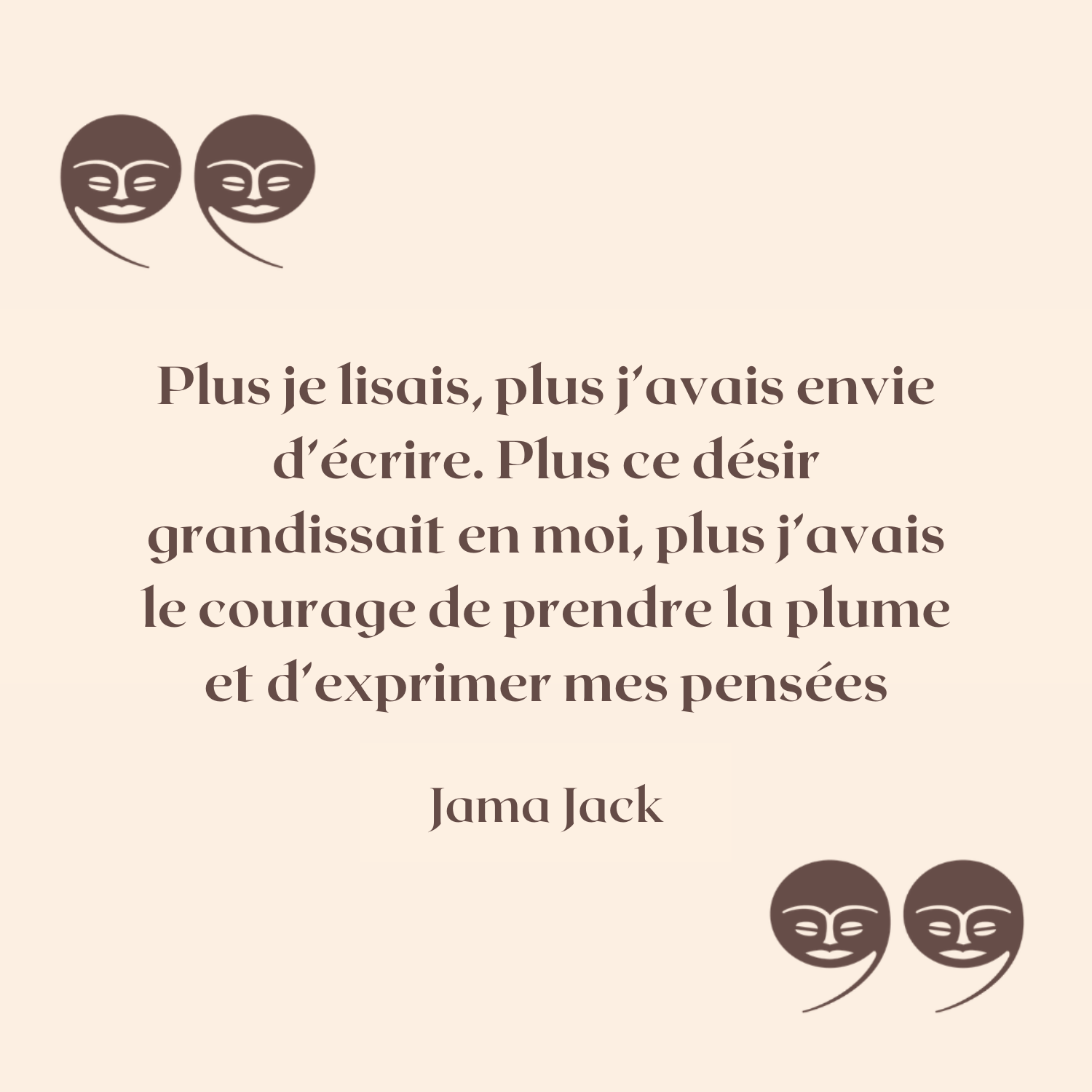Le féminisme au Tchad : entre hostilité et résistance - Épiphanie Dionrang
/Il existe des lieux qui ne sont pas que des espaces physiques, mais des foyers de transformation. Des lieux où les mots sont semés comme des graines de conscience. Le cercle Eyala, tenu à N’Djamena le 17 juin 2025, fut l’un de ces lieux. Un espace féministe, vivant, vulnérable, radicalement humain. Ce cercle n’était pas seulement un rendez-vous de militantes féministes, c’était un miroir tendu à nos intimités, à nos expériences, à nos douleurs, à nos contradictions. Ce que j'y ai entendu, ressenti, pensé continue de m'habiter.
Que signifie être féministe au Tchad ? C’est autour de cette question que les discussions ont commencé. Dans les échanges, plusieurs participantes ont partagé qu’elles vivaient déjà des valeurs féministes avant même d’avoir le vocabulaire féministe pour les nommer. Résister à une tradition humiliante, élever sa fille autrement, refuser une injonction silencieuse… autant d’actes de rupture avec le système patriarcal.
Une participante a dit : « J’étais une féministe, mais je n’avais pas la définition. J’ai compris que je l’étais depuis le bas âge, quand j’ai intégré la Ligue tchadienne des droits des femmes. » Cette parole illustre bien nos processus de devenir féministe. Ce décalage entre le vécu et le langage me paraît crucial. Il rappelle que le féminisme n’est pas une théorie importée, mais une pratique qui s’enracine dans des vies. Ce que beaucoup vivent, en s’opposant aux normes patriarcales, sans forcément le nommer, est déjà, en soi, de la résistance. Toutefois, sans les nommer et sans les inscrire dans le cadre d’une lutte globale pour la libération des femmes, ces actes de résistance restent souvent invisibles, non reconnus, isolés.
Mais nommer, justement, fait peur. Dans le cercle, les témoignages d’hostilité, de rejet, parfois même de violences, étaient nombreux. Le féminisme est perçu par beaucoup comme « occidental », une rébellion contre « l’ordre naturel » ou « les valeurs africaines ». On y voit une idéologie étrangère, occidentale, qui viendrait corrompre nos traditions. Au Tchad, parler de féminisme, c’est encore se heurter à une incompréhension profonde. On caricature, on diabolise, on marginalise. La peur est omniprésente. Peur de perdre son emploi lorsqu’on dénonce le harcèlement en milieu professionnel, un phénomène dont beaucoup de femmes tchadiennes ont témoigné. Peur d’être stigmatisée dans sa famille ou son quartier. Peur aussi d’être seule, isolée dans un combat qui semble parfois trop lourd à porter.
Ces peurs, créées et renforcées continuellement, empêchent d’agir, de parler, de contester. Ce sont des moyens de maintien de l’ordre patriarcal. Et c’est un fait qui n’est pas anodin. Il révèle quelque chose : si le féminisme dérange à ce point, c’est qu’il est puissant. C’est une force de déstabilisation des rapports de pouvoir, et c’est précisément ce qui le rend nécessaire. Comme le disait une participante au cercle : « Le système patriarcal donne le pouvoir aux hommes sur les femmes, avec tout ce qui l’accompagne : les injonctions à la soumission faites aux femmes, l’usage de la religion… Donc, quand on se dit féministe, c’est qu’on peut défier ce pouvoir. »
Les réactions défensives face aux féministes traduisent la peur de perdre des privilèges, de voir vaciller un pouvoir masculin transmis de génération en génération. Cependant, l’acharnement contre les féministes, loin de les faire taire, les oblige souvent à se renforcer. Une autre participante a dit : « On apprend à être solide parce qu’on n’a pas le choix. » C’est vrai, mais c’est aussi épuisant. Les attaques contre les féministes, en famille, au travail, dans la société, pèsent, isolent, et blessent. Encaisser tout le temps des coups, des insultes, des mises à l’écart a des conséquences.
J’ai moi-même subi du cyberharcèlement pour mes prises de position féministes. Des attaques cruelles, traumatisantes, venues d’inconnus mais aussi de proches. Ce qui m’a tenue debout, ce sont les messages, les appels, les voix de mes sœurs en lutte. Leur solidarité et sororité m’ont portée. Pour moi, la sororité est un muscle. Elle se construit, se travaille, se pratique. La sororité est un espace de soin, mais aussi un outil politique. Dans nos cercles, on s’écoute, on se serre dans les bras, on pleure parfois. On partage aussi des savoirs, des stratégies, et aussi des contradictions parfois…
La sororité ne nie pas les conflits ; au contraire, elle permet de les aborder sans violence destructrice. Car oui, il y a des tensions entre féministes ; des fossés générationnels ; des écarts entre militantes des villes et des campagnes ; des incompréhensions entre celles qui parlent le langage académique et celles qui viennent du terrain. Il y a aussi de l’ego, parfois. Des compétitions, des non-dits, des hiérarchies reproduites malgré nous. Nous pouvons apprendre à gérer les contradictions sans perdre l’esprit de construction collective. Et c’est possible avec un esprit sorore. Cela implique d'accepter que nous sommes à des étapes différentes de nos cheminements féministes. Cela exige aussi de se remettre en question, d'écouter les critiques, désamorcer les conflits sans violence symbolique. Aussi, de se rappeler qu’un féminisme qui exclut, qui humilie ou qui méprise est un féminisme qui trahit sa raison d’être. Et surtout, ne pas oublier notre adversaire commun : le patriarcat.
Un autre point discuté lors du cercle et qui m’a marquée, c’est l’appel à une éducation féministe accessible et contextualisée. Un des défis majeurs du féminisme tchadien aujourd’hui est celui de l’accès à l’éducation féministe. C’est un chantier indispensable. Il ne s’agit pas simplement de transmettre des savoirs, mais de faire naître une conscience critique, une capacité à interroger le monde, à contester les normes qui nous oppressent. Il est aussi impératif de donner aux militantes les outils intellectuels et politiques nécessaires pour faire face aux arguments fallacieux, aux traditions figées, aux institutions hostiles. Il faut créer des programmes éducatifs qui parlent les langues locales, qui intègrent les récits des femmes rurales, qui tiennent compte des traditions pour mieux les interroger. Il faut une pédagogie populaire et intersectionnelle.
Trop souvent, l’accès aux savoirs féministes dépend de la langue, du niveau d’études, des réseaux internationaux. L’éducation féministe doit circuler dans les quartiers, les villages, les écoles. Elle doit parler les langues locales, s’adapter aux réalités de celles qui n’ont jamais mis les pieds à l’université. Un point qui a été évoqué lors du cercle et qui m’a parlé, c’est que les espaces de parole entre féministes en Afrique sont des lieux d’éducation politique au sens le plus fort du terme. Ce sont des lieux où l’on réinvente le monde, où l’on détricote les oppressions, où l’on partage des savoirs souvent tus. Ces espaces de parole entre féministes doivent être protégés, nourris, étendus.
Le cercle Eyala a été bien plus qu’une discussion, il fut un refuge. Dans une société tchadienne encore largement marquée par les normes patriarcales, où être féministe reste encore trop souvent un acte de défiance, voire de mise en danger, j’ai vécu le temps du cercle comme une bulle de sécurité. Les espaces comme le cercle sont encore trop rares au Tchad. Trop peu d’endroits où l’on peut parler sans peur, où notre parole est entendue. Militer dans un environnement hostile use le corps, le cœur, les nerfs. Il faut des espaces entre féministes. Des lieux où se déposer, pleurer sans honte ; où parler du burn-out, de la fatigue, du découragement ; où l’on peut dire « je n’en peux plus » sans se sentir faible.
De tels espaces sont des conditions favorables à la survie, à la résistance. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seules, que nos combats sont partagés, et qu’ils valent la peine d’être menés, même à contre-courant. Le féminisme n’est pas qu’un combat, c’est aussi une reconstruction intérieure. Et cette reconstruction a besoin de rituels, de douceur, de pauses, de communauté. Il nous faut plus d’espaces entre nous. Nous devons les multiplier, les faire exister hors des capitales, hors des cercles restreints d’initiées. Le féminisme tchadien ne pourra s’imposer que s’il est capable de parler aux femmes tchadiennes de tous les horizons, de prendre en compte leurs réalités, leurs langages, leurs résistances spécifiques.
Les conversations dans leur ensemble m'ont fait prendre conscience que, malgré les violences structurelles que subissent les femmes au Tchad, elles sont là, debout, prêtes à se battre. Prêtes à nommer les oppressions, à dénoncer les injustices, à résister ensemble. Oui, les limites sont grandes. Oui, les obstacles sont nombreux. Mais il y a de l’espoir. Je suis ressortie de ce cercle en me disant que je vais continuer à parler, à résister. Je refuse de laisser les autres écrire nos histoires à notre place.
Que pensez-vous de cet article?
Vous pouvez écrire un commentaire ci-dessous, ou nous rejoindre pour échanger sur Twitter, Facebook ou Instagram. On a hâte de vous lire !
Épiphanie Dionrang est une militante féministe tchadienne, et présidente de la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes. Artiste slameuse, elle utilise le slam pour dénoncer les injustices.