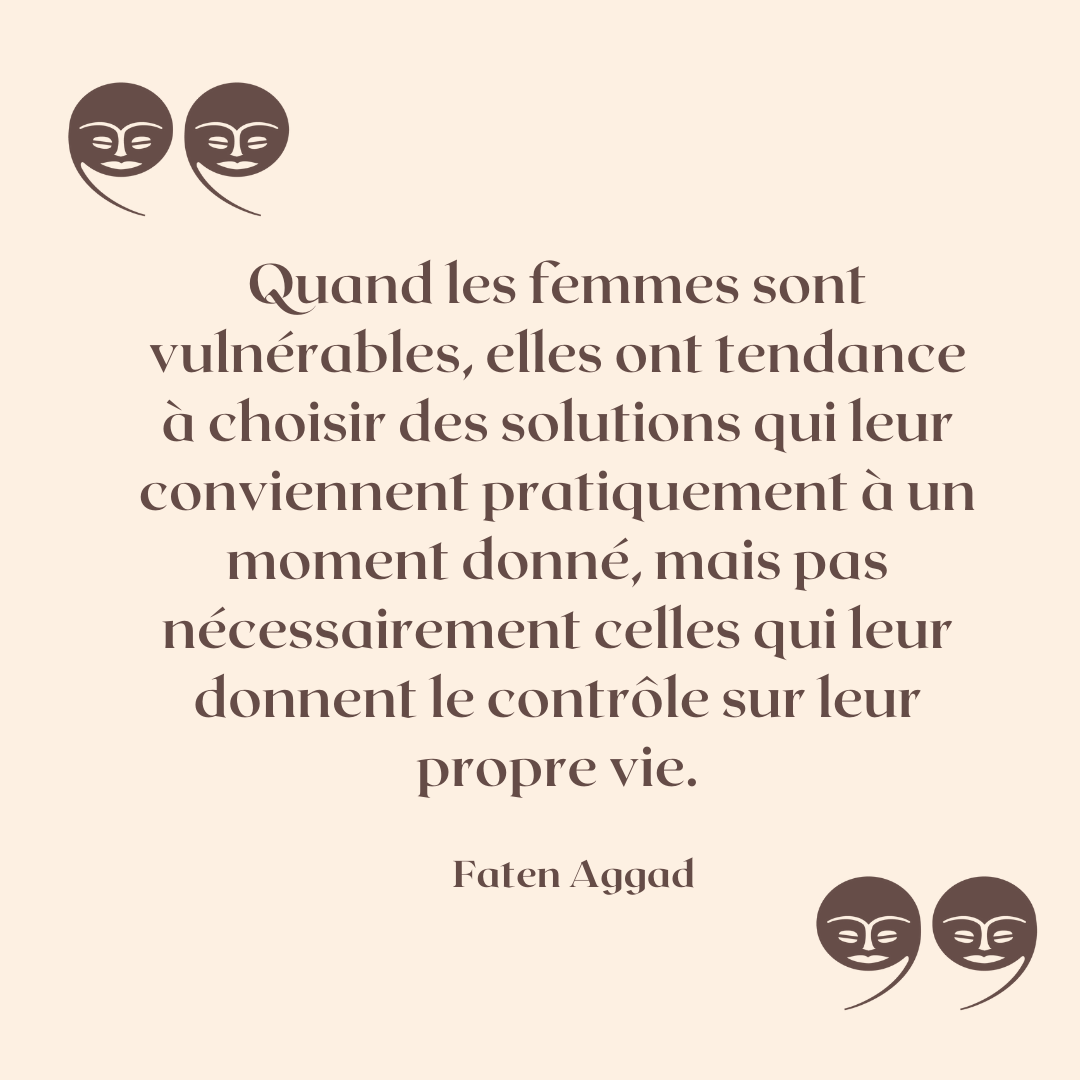« Nous devons canaliser toute notre colère afin de préserver les droits concernant l’avortement qui existent déjà » - Dr Satang Nabaneh (Gambie)
/Par Jama Jack
Une récente fuite a révélé l’intention de la Cour suprême des États-Unis d’annuler l’arrêt historique Roe v. Wade qui garantissait des protections constitutionnelles fédérales pour le droit à l'avortement dans le pays. Une indignation légitime a résulté de cette fuite, avec des appels à la résistance pour s’assurer que le droit à l'avortement reste accessible à toutes les personnes qui accouchent, partout dans le monde.
Si cet événement affecte directement les États-Unis, les répercussions sur le droit à l’avortement, et d’un point de vue plus large, sur les droits sexuels et reproductifs dans la communauté internationale sont évidentes.
Nous avons discuté avec le Dr Satang Nabaneh, universitaire et militante féministe originaire de la Gambie à propos de la récente évolution de la situation. Satang a mené des recherches approfondies sur le droit à l'avortement en Afrique. Elle a également participé à la création de mouvements et au plaidoyer politique dans ce domaine. Dans cet entretien, nous parlons de ce que la décision de la Cour Suprême des Etats Unis signifierait pour les pays africains, et la manière dont les féministes Africaines peuvent se mobiliser. Voici notre bref entretien.
Bonjour Satang ! Merci d’avoir accepté notre invitation à parler de cette question importante. Peux-tu brièvement te présenter et expliquer ce que tu fais à notre communauté ?
Je m’appelle Satang Nabaneh, je suis originaire de la Gambie et je vis actuellement aux États-Unis. Je suis universitaire et militante féministe, et fière de l’être. Mon objectif est de lier la théorie et la pratique. Mon travail féministe, à travers l'activisme, la recherche orientée vers l'action et la production équitable de connaissances sur diverses questions dans le cadre d'efforts collectifs continus, est largement orienté vers la remise en cause des inégalités entre les sexes et d'autres inégalités croisées.
Parle moi un peu de ton travail autour du droit à l’avortement. Qu’est-ce qui t’as menée vers ce parcours et à quoi ressemble ton expérience jusqu’ici ?
Je suis née et ai grandi dans une société essentiellement musulmane en Gambie, où le droit à l’avortement est très restreint. Si la religion a une place primordiale dans ma vie, je me considère comme une féministe avec de très fortes convictions pro-choix, et ayant défendu toute ma vie l'autonomie corporelle, la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que l'égalité des sexes. C'est ce qui a suscité mon intérêt dans la cocréation du Sexual Reproductive Rights Network, organisé par Think Young Women, une organisation féministe dirigée par des jeunes femmes que j'ai cofondée en Gambie.
En raison de mon désir de longue date de contribuer à la promotion de la justice sociale et reproductive, j'ai plaidé et mené des recherches visant à découvrir comment les lois, les politiques, les facteurs socioculturels et institutionnels affectent la santé et les droits sexuels en Afrique. À l'université de Pretoria, j'ai mené des recherches féministes sociojuridiques pour ma thèse de doctorat, et j’ai un livre à paraître sur l'avortement et l'objection de conscience en Afrique du Sud. J'ai également dirigé plusieurs projets universitaires sur les droits de l'homme, le genre et la santé et les droits sexuels et reproductifs. J'ai été chargée de fournir un soutien technique au rapporteur spécial de l'Union africaine sur les droits de la femme en Afrique, d'entreprendre des actions de plaidoyer pour la mise en œuvre du protocole de Maputo et de former les gouvernements africains et la société civile aux systèmes africains des droits de l'homme.
Aux échelles internationale, régionale et nationale, mon activisme et mes recherches ont été clairement axés sur la remise en question et le développement d'idées sur les facteurs politiques et juridiques déterminants dans le cadre d'un discours plus large sur les droits sexuels et reproductifs liés à l’Afrique.
« Si la religion a une place primordiale dans ma vie, je me considère comme une féministe avec de très fortes convictions pro-choix.»
Il y a quelques jours, nous avons appris par la fuite d’un document de la Cour suprême, que cette dernière envisageait d’annuler l’arrêt Roe v. Wade. Quelles sont tes premières réactions face à ce rebondissement ?
La fuite indique que la Cour suprême des États-Unis pourrait annuler l’arrêt Roe v. Wade de 1973. Lorsque (et non si) cela arrivera, cela constituera une violation manifeste des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le pays. Les personnes qui peuvent donner naissance ne devraient pas être forcées à mener des grossesses à terme. Cela représente un éloignement dangereux des normes internationales en matière de droits de l'homme et un geste politique fort signalant une position conservatrice à l'égard du droit à l'avortement. Cela exacerbera l'opposition internationale et nationale à l’accès aux services sexuels et reproductifs tels que l'avortement, le planning familial et l'éducation complète à la sexualité (ECS).
Cela se déroule actuellement au États-Unis, mais l’impact potentiel de cette décision sur le monde est alarmante. À quelles répercussions pouvons-nous nous attendre, et que signifieront celles-ci pour les personnes qui accouchent dans les pays africains ?
En raison du pouvoir et de l’influence des États-Unis, ce qui s’y passe actuellement pourrait sérieusement menacer le droit à l’avortement dans le reste du monde et l’Afrique ne fera pas exception. Malgré l'engagement à faire progresser l'accès à l'avortement, cela révèlera la position des États-Unis sur la question, surtout si les Républicains gagnent du pouvoir, cela affectera également le financement et les politiques dans le pays.
Nous avons vu les implications de la « règle du bâillon mondial », selon laquelle les organisations internationales (non américaines) qui reçoivent des fonds américains ne peuvent fournir un accès, donner des informations ou faciliter l’accès à l'avortement. Le président Joe Biden a mis fin à cette règle lorsqu’il est entré en exercice en 2021.
Il est important de souligner que l'Afrique a connu des développements régionaux significatifs et des réformes nationales qui ont abouti à ce qu'au moins plus de la moitié des pays africains autorisent désormais l'avortement pour des raisons qui concernent la santé de la femme. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (protocole de Maputo) de 2003 est l'un des instruments les plus complets et les plus progressistes en matière de droits fondamentaux des femmes adoptés par l'Union africaine (UA) et a été ratifié par 42 États membres. Il existe des preuves montrant la progression des pays africains dans l'amélioration de la législation et des politiques grâce à une sensibilisation soutenue, notamment à propos de la libéralisation de la loi sur l'avortement, élargissant ainsi les motifs de viol, d'inceste et de danger pour la santé ou la vie du fœtus.
Et crois-tu que cela suffira à bloquer les retombées des événements aux États-Unis ?
Le renversement envisagé des progrès obtenus grâce à Roe v Wade pose un précédent négatif pour la communauté internationale. Nous avons vu la montée des activités et de la visibilité du mouvement anti-choix sur le continent lié à des acteurs ultra-conservateurs basés dans les pays du Nord. Ces organisations situées localement en Afrique sont financées et affiliées à des acteurs occidentaux en créant des bureaux satellites ou des branches régionales. Elles font des campagnes conjointes et autres stratégies collectives.
Par exemple, les arguments avancés dans l'affaire de l'enterrement des restes de fœtus en Afrique du Sud, Voice of the Unborn Baby NPC et l'archidiocèse catholique de Durban contre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé sont similaires aux arguments avancés dans l'affaire Box v Planned Parenthood de 2019. Dans cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a décidé de confirmer la constitutionnalité de la loi sur l'avortement de l'Indiana qui impose à tout clinicien ou établissement fournissant des services d'avortement d'enterrer ou d'incinérer les restes fœtaux plutôt que de les éliminer comme déchets médicaux.
J'ai récemment fait partie d'une équipe d'universitaires et de militant.e.s qui a réalisé une cartographie commandée entre 2020 et début 2021 de la mobilisation contre les droits sexuels et génésiques dans trois pays : le Ghana, le Kenya et l’Afrique du Sud. Nous avons cherché à comprendre la nature transnationale de ce lobbying, les discours principalement utilisés, et l'impact sur le débat public et les sphères juridiques, politiques et éducatives dans les trois pays. Nous avons découvert comment des ONG ultra-conservatrices ont non seulement coopté le discours sur les droits de l'homme, mais également l’existence de liens clairs entre les organisations nord-américaines, qui se décrivent comme « pro-famille », et les groupes locaux du continent africain qui partagent les mêmes idées.
Au fil des années, nous avons également constaté que les représentant.e.s des gouvernements africain.e.s aux Nations Unies étaient du côté conservateur de l’échiquier. Par exemple, les États membres du Groupe africain se sont opposés à plusieurs résolutions relatives aux questions d'éducation complète à la sexualité, d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Cela n'est pas surprenant car les organisations conservatrices ont non seulement des liens étroits avec les acteurs de la lutte contre les droits de l'homme en Afrique, mais elles mènent également un plaidoyer ciblé sur les représentants de l'Afrique au sein des Nations Unies.
En substance, je vois une « menace politique » plus évidente pour de nombreux pays africains, notamment pour des pays tels que l'Afrique du Sud qui disposent d'une législation solide, et peut-être une menace juridique pour les pays africains qui veulent faire pression pour une législation plus conservatrice limitant l'accès à l'avortement.
Si cette situation a suscité une grande indignation (à juste titre !), des voix se sont également élevées pour exprimer l’espoir de la mise en place d’une résistance. Que pouvons-nous réellement faire ? Comment crois-tu que les féministes africaines pourront s’organiser et agir pour protéger le droit à l’avortement ?
Nous devons canaliser toute notre colère pour agir afin de sauvegarder les droits concernant l’avortement qui existent déjà et empêcher tout retour en arrière. Les féministes africaines doivent continuer à se contre-mobiliser et à répondre aux réactions négatives et aux efforts continus pour réduire les droits durement acquis en Afrique. Bien qu'ils ne soient pas monolithiques, les réseaux pro-SRR ont besoin d'une action plus unifiée. Compte tenu de l'agilité et de la présence d'un fort mouvement anti-SRR, nous ne devons pas ignorer les tendances mondiales. À l'ère de la montée des politiques de restauration masculiniste, de la gouvernance autoritaire, de la montée du populisme et de la suprématie blanche, nous devons être stratégiques. Nous devons tirer parti de l'organisation intersectionnelle comme une stratégie qui construit la solidarité entre les enjeux, les organisations et les communautés. Le pouvoir se trouve dans l'action collective !
Absolument ! Nous ne pouvons pas conclure cet entretien sans te poser la question phare d’Eyala : quelle est ta devise féministe ?
J’ai récemment adopté « Lever les yeux au ciel = pédagogie féministe » tirée du livre Living a Feminist Life (en français : Vivre une vie féministe) de Sara Ahmed. Sara nous rappelle que lever les yeux au ciel est une stratégie du féminisme dit rabat-joie ; un langage commun que nous partageons avec les autres féministes pour exprimer nos opinions en public.
Je suis totalement d’accord ! Nous levons tous.tes les yeux ciel face à cette décision de la Cour suprême. Nous avons apprécié d’avoir ton ressenti, Satang. Merci d’avoir pris le temps de le partager avec nous.
Ressources supplémentaires
Satang Nabaneh, The Status of Women’s Reproductive Rights in Africa, Völkerrechtsblog, 09.03.2022, doi: 10.17176/20220309-120935-0.
Satang Nabaneh, ‘The Gambia’s Political Transition to Democracy: Is Abortion Reform Possible?’ (December 2019) 21(2) Health and Human Rights Journal 167-179.
Satang Nabaneh, ‘Abortion and ‘conscientious objection’ in South Africa: The need for regulation’ in E Durojaye, G Mirugi-Mukundi & C Ngwena (eds) Advancing Sexual and Reproductive Health and Rights in Africa: Constraints and Opportunities (Routledge, 2021) 16-34.
Faites partie de la conversation
Nous avons hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez écrire un commentaire ci-dessous, ou on pourrait se causer sur Twitter, Facebook ou Instagram @EyalaBlog.
Pour les actualités de Satang, c’est sur Twitter @DrSatangNabaneh